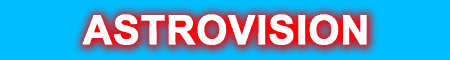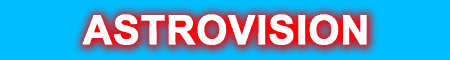La magnitude
Pour mesurer la luminosité ou brillance des
astres, les astronomes utilisent une unité appelée magnitude.
Il existe deux types de magnitude :
- La magnitude apparente
- La magnitude absolue
Explications
Plus un astre est
brillant, plus sa magnitude
est petite (voire négative). Ainsi
une étoile de 1re magnitude est plus brillante qu'une
étoile de 2e magnitude. En fait la magnitude
est une grandeur qui permet de mesurer la luminosité des astres.
Origines de la magnitude
Nous la devons à
l'astronome grec Hipparque (IIe
siècle av J-C). Il fut l'un des premiers astronomes de
l'Antiquité à collecter des informations pour
bâtir des catalogues stellaires
donnant la position et l'éclat des étoiles visibles
à l'oeil nu. Son plus grand catalogue comprenait un peu plus de
1000 étoiles. Les vingt plus
brillantes étaient classées
dans la catégorie "étoiles de première grandeur",
les autres se répartissaient ensuite sur cinq
échelons, jusqu'aux "étoiles de sixième
grandeur" qui étaient les plus faibles visibles à l'oeil nu.
Après avoir
pointé vers le ciel sa première lunette astronomique,
Galilée fut contraint
d'inventer la 7e magnitude pour désigner les étoiles invisibles
à l'oeil nu mais révélées par son instrument.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les astronomes
ajoutèrent peu à peu de nouveaux
échelons mais sans vraiment modifier la logique
du système inventé près de 2000 ans plus tôt
! Il devint alors urgent, pour faire face à l'inflation des
catalogues stellaires, de ne pas laisser la classification des magnitudes
à la seule perception de l'oeil humain, et de mettre
en évidence une loi de variation de luminosité des astres.
Le premier qui formalisa le passage d'une magnitude à une autre
fut l'astronome anglais Norman Pogson. En 1856, il
proposa de considérer qu'une différence de
5 magnitudes était égale à une
différence d'éclat de 100 fois. Le rapport
entre deux échelons de magnitude devenait alors égal à
la racine cinquième de 100 soit 2,512 fois.
Pour Hipparque et pour tous les savant jusqu'au XIXe
siècle, les étoiles les plus brillantes étaient
toutes de 1re grandeur, sans qu'il soit fait aucune distinction dans
ce groupe. Pourtant, il était manifeste à l'oeil nu que
Sirius était nettement plus brillante que Véga, alors
que les deux astres se trouvaient sur le même échelon de
magnitude. La création d'appareils capables de mesurer
précisément des éclats (photomètres)
permit de dépasser cette limite et d'appliquer la formule de
Pogson à tous les astres. L'échelle
des magnitudes débutant initialement à l'unité,
les astres plus brillants furent dotés
de magnitudes plus petites, voire négatives.
La magnitude apparente de Sirius devint ainsi égale à
-1,46 et celle de Véga à + 0,03. La magnitude apparente
de Véga est donc 3,9 fois moindre que celle de Sirius
(2,512(0,03+1,46)).
Aujourd'hui, l'échelle de magnitudes
s'étend de -26,74 (Soleil) à
+30 (galaxies photographiées par
le télescope
spatiale Hubble en 18 heures de pose
!).
Magnitude apparente et magnitude
absolue
Il ne faut pas confondre
la magnitude apparente et la magnitude absolue.
La magnitude apparente
s'applique aux étoiles et aux planètes et fait référence
à leur éclat apparent depuis la Terre.
La magnitude absolue indique
l'éclat qu'auraient les étoiles si on
les plaçait à la même distance de la
Terre (en l'occurrence à 32,6
années-lumière, soit 10
parsecs)
La magnitude apparente ne
nous renseigne en rien sur l'éclat
réel de l'astre et ne donne aucune indication sur sa nature
physique, ce que fait en revanche la magnitude
absolue. Ainsi, lorsque vous découvrez un beau ciel, les étoiles
les plus brillantes, celles qui possèdent les magnitudes apparentes les
plus fortes, ne sont pas forcément les plus grosses et les plus lumineuses !
Comparaisons
|
Astre
|
Magnitude apparente
|
|
Soleil
|
-27
|
|
Pleine Lune
|
-13
|
|
Vénus (planète la
plus brillante)
|
-4
|
|
Sirius (étoile la plus
lumineuse)
|
-1
|
|
Limite de sensibilité de
l'oeil nu
|
5
|
|
Pluton (planète la moins
brillante)
|
14
|
|
Limite de sensibilité de
Hubble
|
30
|
Page non trouvée dans comprendre_pages
Auteur : Didier Walliang
Textes tirés du Guide du ciel de Guillaume Cannat (Nathan)
|